
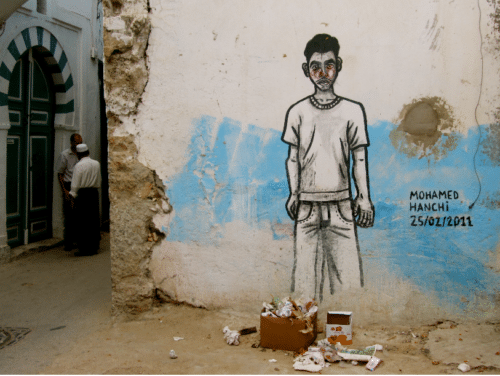
Notre sang n’a pas l’odeur du jasmin : fragments d’une mémoire éclatée
Notre sang n’a pas l’odeur du jasmin est un spectacle qui ne se raconte pas, il se traverse. Comme une brûlure lente, comme une archive vivante que l’on exhume à voix nue. Il ne s’agit pas ici de rejouer l’Histoire, mais de glisser dans ses interstices — là où les récits officiels s’effacent, là où les corps témoignent à leur manière, depuis les marges, depuis l’exil intérieur.
Sur scène, la parole se fait chair. Elle dit l’indicible : l’expérience postcoloniale, le poids du silence transmis, les révoltes étouffées sous le parfum folklorisé d’un jasmin trop souvent fétichisé. Le jasmin, ici, n’a rien de romantique. Il est le masque d’une mémoire domestiquée, un symbole vidé de son sang.
Le texte — à la fois brut et ciselé — se déplie comme une incantation. Il convoque des figures familiales, des gestes hérités, des fragments d’archives personnelles. Le corps de l’interprète devient lieu de passage, interface entre générations. La mise en scène est minimale, mais chargée. Chaque mouvement, chaque silence, chaque éclairage dessine un espace mental : celui de l’entre-deux, de l’identité fracturée mais résistante.
Ce spectacle n’est pas un cri, c’est une fissure. Un lieu où le politique affleure sans slogan, où le poétique ne gomme pas la douleur. Il interroge la possibilité même de témoigner, sans céder au didactisme. Il s’adresse à celles et ceux qui portent en eux des héritages lourds, des colères muettes, des appartenances multiples.
Notre sang n’a pas l’odeur du jasmin est une œuvre rare, qui touche par sa justesse, sa pudeur et sa densité. Elle fait de la scène un territoire de réappropriation : des récits, des corps, des mémoires qu’on avait voulu effacer. Et elle nous rappelle, avec force, que raconter n’est jamais neutre — surtout quand notre sang n’a jamais eu le luxe de sentir bon.